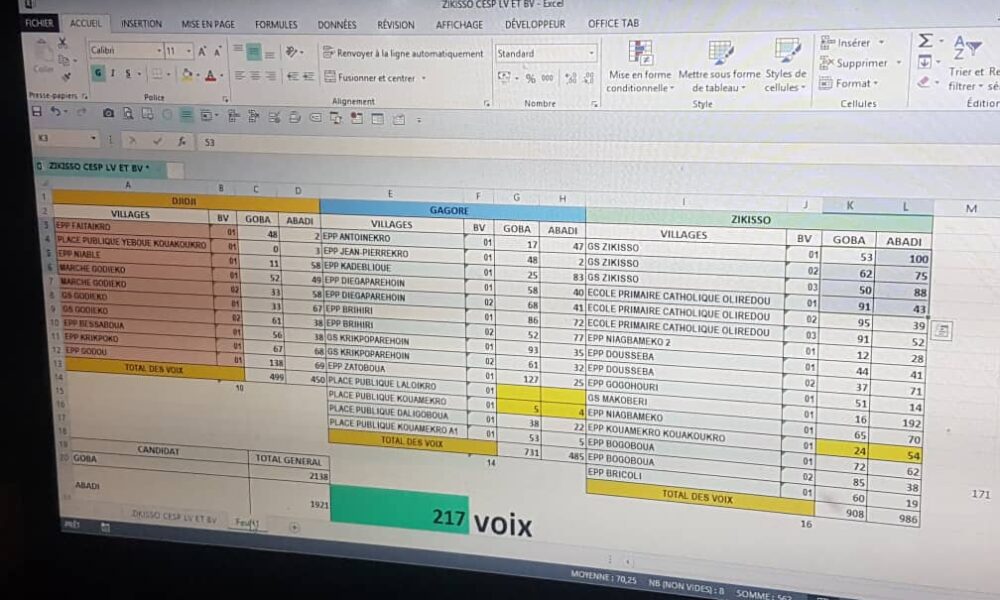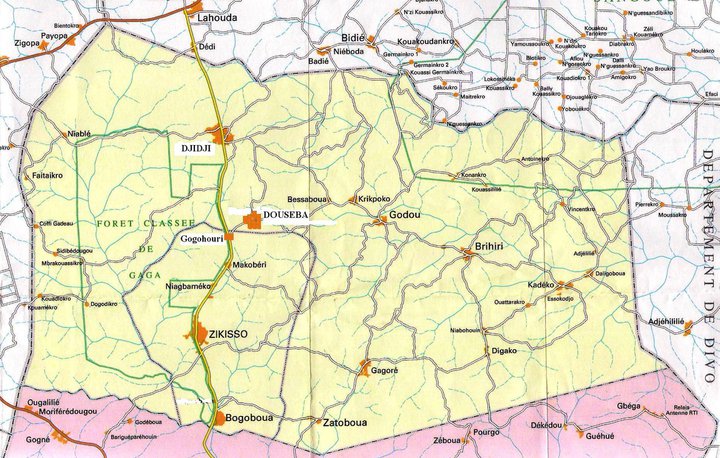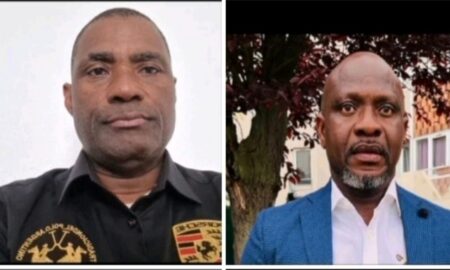LE MONDE | • Mis à jour le | Par Cyril Bensimon

« Le putsch est terminé, n’en parlons plus », a souhaité le général Gilbert Diendéré, le leader de l’éphémère junte au Burkina Faso, au moment où le pouvoir venait de lui échapper, mercredi 23 septembre. Il y a pourtant tant à dire. Quelques minutes avant que le chef putschiste fasse son acte de contrition, le président intérimaire, Michel Kafando, et son premier ministre, Isaac Zida, avaient feint l’étonnement de voir les autorités de transition renversées par le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l’incarnation des « forces du mal ».
Le feu couvait pourtant depuis des mois. Quelques jours avant la proclamation du putsch, le 17 septembre, des responsables de l’ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ou leurs proches avaient laissé entendre que « quelque chose allait arriver », que la tenue des scrutins présidentiel et législatif à la date prévue n’était « pas sûre ». La collusion entre les ex-prétoriens de Blaise Compaoré et les cadres politiques de l’ancien régime, qui avaient soutenu un an plus tôt la modification de la Constitution devant permettre au président du Burkina Faso de prolonger son bail à la tête du pays, est évidente.
La purge est désormais engagée, elle frappe sans discernement, et, à Ouagadougou, rares sont les voix qui s’en émeuvent. La répression orchestrée par les nervis de la junte a fait, selon le bilan officiel, 11 morts et 271 blessés. Le RSP, qui bénéficiait de tous les privilèges du temps de Blaise Compaoré, a été dissous, des procédures judiciaires ont été engagées, les avoirs de personnalités ou de partis politiques,« auteurs et complices présumés du coup d’Etat », ont étégelés. Les arrestations ont commencé. Dans leur aventure sans lendemain, les militaires putschistes et leurs alliés politiques ont précipité ce que les autorités de transition ont tenté de mener à bien depuis près d’un an : la dislocation du régime Compaoré.
Lire aussi : Au Burkina Faso, le général Diendéré reconnaît ses « torts » après son coup d’Etat
Une loi électorale bancale

Il n’en demeure pas moins que le pouvoir né de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 n’est pas exempt de tout reproche. La faute originelle des autorités de transition est d’avoir nommé un officier venu du RSP à la tête du gouvernement. Faute de légitimité élective, le lieutenant-colonel Isaac Zida a multiplié les discours populistes, au point de se retrouver en confrontation ouverte avec ceux qui l’avaient installé aux commandes pour maintenir leurs prébendes. Dès décembre 2014, ses anciens frères d’armes ont tenté d’obtenir sa tête. Depuis, la transition au Burkina Faso vogue sur des eaux incertaines, faite de vrais et de faux complots.
L’exclusion de dizaines de candidats issus de l’ancien pouvoir pour les futures élections présidentielle et législatives, initialement prévues le 11 octobre mais désormais reportées de « quelques semaines », a été un prétexte tout trouvé pour les putschistes. Cette éviction de la course au pouvoir a été menée avec une loi électorale bancale, condamnée par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao). La France et les Etats-Unis ont également souhaité voir se tenir des « élections inclusives », mais sans jamais hausser le ton.
« Vu de Paris, c’est une transition plutôt sympathique, estime un diplomate burkinabé. Le contexte était jusque-là suffisamment tranquille pour ne pas s’émouvoir de l’exclusion des gens de Blaise [Compaoré]. Pour nos partenaires occidentaux, le Burkina Faso devait être le modèle d’une insurrection populaire réussie. Dans ce schéma, seule l’organisation d’élections compte. » Après l’échec du Burundi, le Burkina Faso devait servir d’avertissement aux présidents africains qui tentent de s’agripper au pouvoir au-delà de la limite que leur a fixée la Constitution (Congo, République démocratique du Congo, Rwanda).
Lire aussi : Qui est Chérif Sy, le réformateur intraitable du Burkina Faso ?
« Il y a un sentiment humain très compréhensible de vouloir tourner la page du CDP et des années Blaise Compaoré, mais si cette question n’est pas traitée dans les urnes, elle reviendra de manière récurrente », analyse pour sa part Laurent Bigot. Cet ancien diplomate, écarté par le Quai d’Orsay pour avoir su prédire un peu trop tôt la chute de Blaise Compaoré, dénonce par ailleurs « la mollesse de la diplomatie française pour défendre les principes sur lesquels les Africains nous attendent ». « A force de réduire le réseau, affirme M. Bigot, Paris n’a pas su se rapprocher de la jeunesse et des mouvements citoyens. Bref, de l’Afrique de demain. »
Par souci de ne plus être taxée d’ingérence, la France s’abrite désormais derrière les positions de l’Union africaine et des organisations régionales. L’ambition d’apporter « des solutions africaines aux problèmes africains » est louable, mais elle comporte ses limites. Dans le cas du Burkina Faso, la Cedeao a démontré qu’elle était une somme de divisions. La médiation lancée par le président sénégalais, Macky Sall, a échoué après avoir repris l’essentiel des revendications de la junte. En Côte d’Ivoire, où Blaise Compaoré a été accueilli en ami après sa fuite du pouvoir et où l’on connaît les conséquences de l’exclusion politique, plusieurs sources officielles, sous couvert d’anonymat, se félicitaient du « coup de force salvateur du général Diendéré ». A l’opposé, au Niger, par proximité avec l’un des favoris du scrutin et par crainte d’un retour des militaires sur la scène politique locale, les autorités ont dénoncé fermement les putschistes burkinabés.
Lire aussi : Burkina : vers une sortie de crise ?
Finalement, la différence est venue de la mobilisation populaire, des organisations de la société civile et de l’entrée en jeu de jeunes officiers qui ont su prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce coup d’Etat. Les diplomates n’ont plus eu qu’à constater.
- Cyril Bensimon
Journaliste au Monde
LAISSER UN COMMENTAIRE